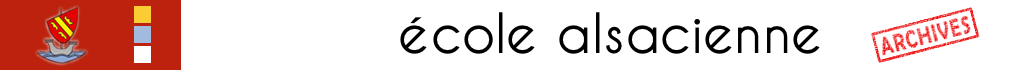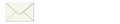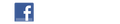Sommaire
Recherche
Connexion
La bonne nouvelle
Josépha Attal, 2de4
L’association Sauvegarde des enseignements littéraires (SEL) a organisé un concours de nouvelles en hommage à Jacqueline de Romilly : il était proposé à de jeunes lycéens d’écrire une nouvelle en lien avec l’Antiquité.
Plusieurs nouvelles issues du concours ont reçu une mention spéciale du jury.
Celle de Josépha Attal en fait partie.
La bonne nouvelle
Josépha Attal, 2de4
— Euclès ! Fais attention !
Le jeune homme fit un saut périlleux des plus improbables pour éviter le seau de soupe brûlante qu’il avait renversé et dont le contenu se répandit sur le sol. Le soldat dont le dîner allait servir de repas aux fourmis, brandit le poing vers lui en étouffant à peine ses jurons.
Euclès s’excusa, ce à quoi le soldat répondit par une gifle retentissante. Heureux de constater qu’on acceptait ses excuses avec autant d’amitié, et tout en se demandant s’il pourrait un jour retrouver l’usage de sa mâchoire, Euclès se hâta de reprendre son chemin. Il zigzagua entre les tentes de ses frères d’armes pour rejoindre la sienne.
Euclès était grand, dégingandé et doté d’une certaine nonchalance.
Il avait dans le regard cette étincelle que confère l’intelligence aux ingénus et tout son corps était guidé par la fougue du maladroit bien intentionné. En effet, il semblait que sa raison et les mouvements de ses membres étaient indépendants l’un de l’autre. Ainsi, malgré toute sa volonté de bien faire, il ne parvenait pas à se rendre utile au moment souhaité, et cette incapacité le désespérait. En un mot, Euclès était un adolescent, qui cachait derrière son corps d’homme un esprit d’enfant.
Quand il atteignit sa tente, il avait déclenché un incendie et réduit à néant deux charrettes de provision de choux. Devant le bout de tissu tendu sur des piquets qui lui servait de tente, se tenaient une douzaine d’autres soldats, l’air passablement joyeux, qui, eux aussi, seraient sûrement ravis d’écouter ses excuses. Dans un élan de clairvoyance, – ou alors était-ce l’habitude ? –, Euclès tourna les talons et courut vers la colline à l’extérieur du camp.
Voilà une chose qu’il savait faire. Courir. Ses grandes jambes ne semblaient plus pouvoir s’arrêter du moment qu’il était résolu et il fendait l’air avec une rapidité divine. La brise dans ses cheveux bruns, le vent qui lui fouettait le visage lui faisaient tout oublier. Il courait, sentait l’effort de ses muscles qui criaient, sentait son coeur battre comme jamais, sentait ses poumons se contracter et se relâcher inlassablement. Depuis toujours il avait couru.
Il avait grandi, un peu à l’écart des autres enfants, passant trop souvent pour le distrait du groupe, dont on se moque un temps avant de se lasser. Son enfance s’était essentiellement résumée au regard d’admiration qu’il avait porté sur les autres, dont il avait vaguement envié les caractères. On l’insultait et le rabrouait, sans jamais parvenir à le détester pour autant : il rappelait trop à ses camarades leur propre supériorité.
Puis, le temps de l’éphébie était arrivé. Son père, conscient des difficultés que rencontrerait son fils, avait tout tenté pour lui éviter d’avoir à accomplir ce devoir civique. Mais la cité, en guerre, ne pouvait tolérer aucune exception. Très vite, cependant, ses lieutenants avaient suggéré à leur supérieur de lui confier un statut un peu à part.
En effet, sur le champ de bataille – à son plus grand désespoir –, Euclès desservait plus qu’autre chose les athéniens.
Ils avaient tant et si bien réfléchi à un moyen de se débarrasser de cet étourdi, que les généraux de l’armée d’Athènes avaient créé un poste spécial : il était estafette.
— Un jour, avaient-ils expliqué à Euclès, nous nous trouverons face à un problème qui nécessitera l’action d’un homme d’exception. Ce jour-là, ce sera à toi d’agir. En attendant reste dans ta tente. Les héros ont besoin de repos.
Ainsi, depuis le début de la bataille, Euclès avait regardé les soldats du haut de la colline où il passait ses journées quand le camp était désert. C’était là qu’il se rendait.
Une fois arrivé, il s’allongea dans l’herbe. Il regardait le ciel en rêvant du jour où il pourrait rendre fier son père, où il graverait son nom dans l’histoire.
Car Euclès était peut-être naïf mais il n’était pas pour autant sot. Il savait bien qu’il ne pourrait jamais accomplir les exploits guerriers auxquels prétendaient ses pairs. Mais ce n’était pas pour autant que son heure de gloire n’arriverait jamais. Il était intimement persuadé, au plus profond de son âme, qu’un jour cette grande occasion se présenterait, et que là, il accomplirait une prouesse, que son nom traverserait les âges, et qui sait… peut-être qu’un jour quelqu’un écrirait son histoire.
Depuis toujours on l’avait regardé comme un bon à rien, (et ce, bien qu’il rattrapait toujours les moutons qui s’échappaient). On ne l’avait jamais destiné à rien de grand, rien de beau, rien de noble. Ce garçon trop grand, aux longues jambes s’était réfugié dans ses rêveries pour ignorer la cruauté du regard de l’autre sur la différence. Ces absences étaient si fréquentes qu’il ignorait même contre qui sa cité était en guerre.
Il ignorait qu’en cet automne de l’an 490 avant Jésus Christ, les grecs scellaient leur destin. Il ignorait que face aux Perses, une armée athénienne dix fois inférieure en nombre tentait de faire front.
Ce qu’il savait en revanche, c’était que chaque soir, à Athènes, le soleil se couchait bercé par les pleurs des mères, des femmes et des filles de la cité. Il lui semblait les entendre lors de ces grands moments de silence dans lequel était parfois plongé le camp.
Le soleil embrasa l’horizon, le zébrant de rose et d’or. Euclès le regarda en descendant de la colline, toujours plongé dans ses songes. Il se réfugia dans sa tente et s’endormit bercé de rêves d’enfants.
Le lendemain, aussitôt réveillé, il sentit que quelque chose allait se produire. Quelque chose qui changerait tout. Comme à l’ordinaire le camp était vide, mais ce jour-là, il n’aurait pas su dire pourquoi, l’atmosphère était différente. C’est la grande force des rêveurs de sentir ce à quoi les autres ne prennent pas garde. C’était peut-être un bourdonnement dans l’air, ou une odeur amenée par la brise, l’absence du chant des oiseaux...
Il faisait une chaleur torride. Le soleil brûlait sans doute les peaux sur le champs de bataille. Il voulut se rendre au puits pour y chercher de l’eau, mais des chants venus de loin interrompirent sa route. Les soldats athéniens rentraient. La vague humaine qui déferla sur le camp apporta avec elle la bonne nouvelle : ils avaient gagné ! Les athéniens, poussés par leur rage de défendre leur foyer, aidé par l’amour de leur cité, et des Dieux sans doute, avaient mis fin à cette guerre. L’euphorie montait jusqu’aux cieux. C’étaient des cris, des rires ou des chants patriotes.
— Euclès ! s’époumonait le général.
Celui-ci s’approcha en tremblant, presque inquiet de se voir ainsi appelé, dans un moment de bonheur commun.
Son supérieur posa ses deux mains sur ses épaules. Son visage ruisselait de sang, de sueur et de larmes et un large sourire fendait son visage.
— Va dire à Athènes que nous avons gagné Marathon. Va leur dire que tout est fini, que nous allons pouvoir rentrer chez nous. Vas-y, cours Euclès ! Cours !
Euclès tourna aussitôt les talons. Il se sentit en une fraction de seconde changé du tout au tout. Il avait trouvé sa grande mission. Il avait enfin une chance de faire ses preuves, de montrer au monde qu’il était un homme, qu’il valait quelque chose.
Il se mit à courir. Il allait retourner à Athènes sans s’arrêter. Car il ne pourrait plus s’arrêter. Pas avant d’avoir fait son devoir. Il allait courir, voler, jusqu’à là bas. Il apporterait le bonheur aux athéniens qui vivaient dans l’angoisse depuis trop longtemps. Il allait rassurer cette mère, calmer cette petite fille. Ni la chaleur, ni la soif, ni la faim ne pourraient le résoudre à abandonner sa route.
 À chacune de ses foulées il marquait un peu plus l’histoire. Ce voyage serait le premier et le dernier. Et une fois sa mission accomplie, il quitterait son corps épuisé sans un regret. L’allégresse ne le quitterait pas au dernier soupir, le bonheur est immortel. Son nom allait traverser les âges et un jour, on écrirait son histoire.
À chacune de ses foulées il marquait un peu plus l’histoire. Ce voyage serait le premier et le dernier. Et une fois sa mission accomplie, il quitterait son corps épuisé sans un regret. L’allégresse ne le quitterait pas au dernier soupir, le bonheur est immortel. Son nom allait traverser les âges et un jour, on écrirait son histoire.
— Réjouissez vous, Athéniens ! Nous avons vaincu.
École alsacienne - établissement privé laïc sous contrat d'association avec l'État
109, rue Notre Dame des Champs - 75006 Paris | Tél : +33 (0)1 44 32 04 70 | Fax : +33 (0)1 43 29 02 84